Châssis et origine particuliers
Le début de l’étude de la remplaçante de la XK débute en 1957 après l’incendie de l’usine de Brown’s Lane.
Le projet est dirigé par William Munger Heynes avec un cahier des charges précis : voiture de 3 litres avec puissance de 285 chevaux pouvant circuler à 40 km/h en 4e. Il Faut 7 semaines pour la construire un premier prototype qui roule en novembre 1957, nom de code E1A.
E1A reprend la structure monocoque de la berline 2,4 litres et de la type D avec la coque en acier remplacée par des panneaux d’aluminium soudés (suffixe A). La structure reprend la technique utilisée sur la D avec un faux châssis boulonné sur le tablier avant et supportant le moteur. Ce prototype Utilise le bloc 2,4 litres à course courte (76×83) poussé à 200 chevaux à cause du capot plongeant très bas et sans phares. La carrosserie est dessinée par Malcolm Sayer.
La voiture inaugure de nouvelles suspensions arrières à roues indépendantes (1ère Jaguar à roues arrières indépendantes). Le système utilise un porte moyeu de chaque côté guidé par un large triangle inférieur et par le demi-arbre faisant office de bras supérieur et 2 combinés ressort/amortisseur par demi-train. Le différentiel est directement fixé sur une traverse solidaire de la caisse.
Les freins arrières sont positionnés in-board de part et d’autre du carter du couple conique pour diminuer le poids non suspendu ce qui entraîne un problème de surchauffe dû à la communication de la chaleur du différentiel aux disques qui ne refroidissent pas et renvoient des calories supplémentaires au couple qui sera résolu par le montage d’un radiateur d’huile.
E1A est une première approche de la future voiture aux cotes de 9/10 laissant entrevoir de bonnes possibilités. Jaguar fabrique alors un 2e prototype E1 bis avec la taille définitive et une carrosserie en tôles d’aluminium rivetées, surnom « spéciale rivets pop ». Parallèlement, on poursuit les essais de la nouvelle suspension sur une berline 3,4 litres pour parfaire les réglages des débattements et les tarages des ressorts et des amortisseurs. La suspension arrière est conçue comme un module indépendant et complet qu’il suffit de boulonner sous la caisse.
Un 3e prototype E2A est construit à la demande de Briggs Cunningham qui souhaite une voiture pour participer aux 24 Heures du Mans 1960. Cette voiture proche est proche de la Type E et reçoit un moteur 3 litres.
Il reprend l’architecture des 2 premiers prototypes avec une carrosserie en panneaux d’aluminium rivetés, l’avant préfigure le modèle définitif et l’arrière rappellant encore la type D (repose tête placé derrière le pilote) et un moteur à bloc en aluminium de 2,4 litres réalésé à 3 litres reprenant la technique de la Type D : carter sec, bielles en titane et pistons haute compression, grosses soupapes et injection Lucas à guillotine, 293 chevaux à 6750 tours. Boîte de vitesses à 4 rapports synchronisés et embrayage tri-disque. Suspensions et freins identiques à ceux de autres prototypes avec différentiel isolé des freins arrières par des écrans thermiques et des gaines d’aération amenant de l’air frais de l’avant pour résoudre les problèmes de surchauffe dus à un usage en compétition.
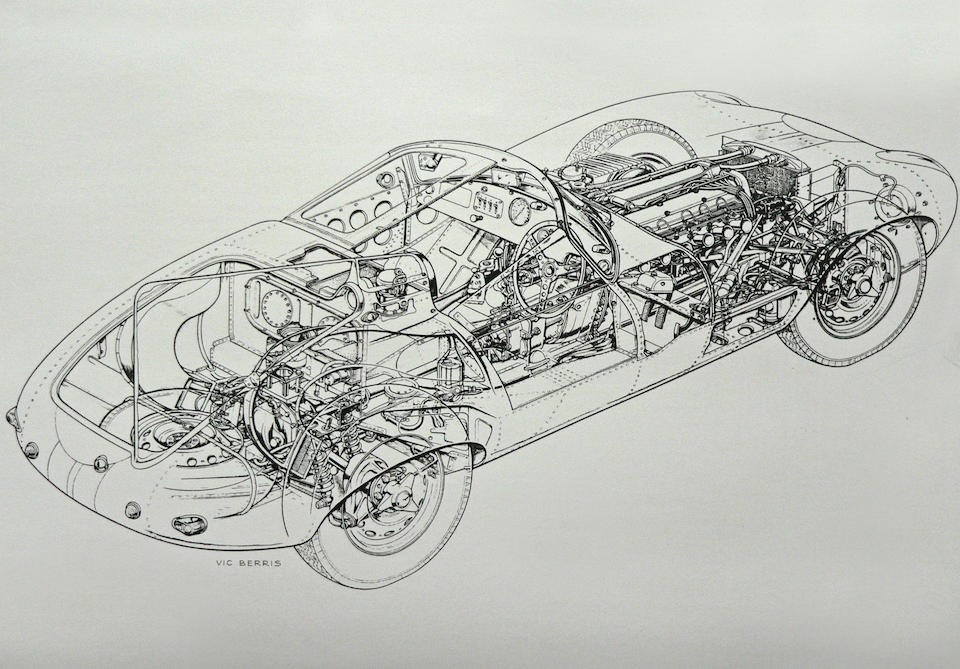
E2A fait ses débuts le 9 avril 1960 aux essais préliminaires du Mans, non peinte (930 kg au pesage) et obtient le 2e meilleur temps malgré une vitesse de pointe de seulement 247 km/h, Walt Hansgen et Dan Gurney se partageant le volant. La voiture retourne à Coventry puis participe aux 24 Heures du Mans (FRA), peinte en blanc avec des bandes bleues et une grande dérive dans le prolongement de l’appuie-tête, E2A abandonne suite à des problèmes d’injection entraînant un claquage de joint de culasse.

La voiture retourne à l’usine pour un changement de pare-brise reçoit alors un moteur 3,8 litres avec alimentation par 3 carburateurs Weber, ce qui entraine un bossage de capot. La voiture est alors engagée à la course de Bridgehampton (USA) ou elle obtient sont seul succès en compétition (Hansgen).

La voiture définitive est présentée au salon de Genève (CH) en mars 1961 et conserve le schéma des prototypes. Le dessin est toujours dû à Malcolm Sayer en 2 versions : coupé et roadster 2 places. La Type E est constituée d’une Coque formant cellule centrale avec un treillis avant supportant le train avant ainsi que moteur et un module arrière recevant la suspension et le différentiel. Le moteur 3 litres en aluminium est abandonné au profit du groupe 3,8 litres de la XK 150S imposant un bossage de capot du fait de sa course plus longue et de l’abandon de la lubrification par carter sec.
La voiture est livrée avec des pare-chocs chromés, 3 essuie-glaces, coffre à bagages, intérieur cuir pleine peau Conolly et une instrumentation complète.



Moteur :
6 cylindres en ligne 3,8 litres de la XK150 S dans sa version 265 chevaux.
Bloc en fonte avec culasse en alliage léger « Straight Port » à flux transversal finalement préféré au bloc en aluminium pour des raisons de rigidité structurelle due aux blocs à longue course. La taille du bloc impose un bossage de capot.
Vilebrequin guidé par 7 paliers.
Lubrification sous pression, contenance du circuit : 7,5 l.
Refroidissement liquide avec pompe et thermostat, 12,5 l avec boîte à eau indépendante pour réduire la hauteur du capot.
Distribution par 2 arbres à cames en tête entraînés par chaîne duplex et soupapes en tête.
Alimentation par 3 carburateurs SU HD 8 de 2 pouces de diamètre avec pompe à essence électrique.
3781 cm3 (87×106), taux de compression : 9,0 :1 (8,0 :1 en option).
265 chevaux à 5500 tours pour un couple de 36 Mkg à 4000 tours.


Transmission :
Boîte de vitesses Moss à 4 rapports, 1ère non synchronisée de la XK 150S.
Embrayage mono-disque à sec.
Rapports de boîte : I. : 3,377 :1 ; II. : 1,86 :1 ; III. : 1,283 :1 ; IV. : 1,0 :1 ; ARR. : 3,377 :1.
Rapport de pont : 3,31 :1.
Différentiel à glissement limité.
Châssis :
La carrosserie nécessite des presses hydrauliques de très grande taille (partie supérieure du capot) imposant une fabrication par 2 sous-traitants : Abbey Panels pour les capots et les panneaux extérieurs et Pressed Steel Fisher pour la coque avec assemblage final dans les ateliers Jaguar de Brown’s Lane, Coventry (G-B). La coque est commune au coupé et au roadster, l’absence de toit n’est pas préjudiciable à la rigidité du cabriolet car la coque est calculée pour cette configuration.




Différentiel, suspension arrière et freins sont réunis dans un berceau en acier facilement déposable (1 heure) maintenu à la caisse par 4 silentblocs plus 2 sur les tirants et un autre berceau tubulaire avant (la Tour Eiffel) supporte le moteur, la direction et les suspensions avant.
Roues à fixation centrale par papillon Rudge et 72 rayons chromés.
Suspension avant par roues indépendantes avec triangles superposés, barres de torsion, amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis transversale.
Suspension arrière indépendante avec pont suspendu solidaire d’un bâti intermédiaire monté sur la caisse par silentblocs. Gain de poids non suspendu (différentiel, étriers et disques arrières accolés au pont) permettant l’adoption d’une suspension plus douce car les rebonds moins violents sont sans impact sur la stabilité de l’auto. W.M. Heynes s’inspire des recherches de Chapman (Lotus) et Mc Pherson : 3 idées de base : importance de la triangulation des moyeux pour la stabilité, élargissement maximum des côtés du triangle pour la répartition des masses et utilisation de l ‘arbre de roue comme élément de triangulation pour économiser le poids d’une biellette inutile. Le train Jaguar reprend ce concept avec un porte-moyeu en aluminium coulé représentant le sommet du triangle formé par une biellette tubulaire transversale montée sur pivots et solidaire du berceau et une jambe de force longitudinale montée sur rotule en caoutchouc et ancrée sous la caisse. Un berceau solidaire de la caisse constitue le 3e côté du triangle. Le porte-moyeu enchâsse l’arbre de roue (arbre de roue et biellette forment un parallélogramme déformable dans le plan vertical). Suspension assurée par 4 ressorts hélicoïdaux reliant biellettes tubulaires et berceau métallique. Ceci permet un guidage très précis du pont, des demi-arbres et des roues. Les couples d’accélération et de freinage sont contraints par l’interaction conjuguée de l’ensemble biellette-demi arbre superposés et jambe de force perpendiculaire. Flexion du berceau de 5° sous couple d’accélération et 3° en freinage grâce au montage sur bague en caoutchouc. Les forces de déport et d’écrasement sont encaissées par le parallélogramme biellette-demi arbre : toutes les roues conservent en permanence le même angle de carrossage quels que soient les virages ou la charge.
Suspension arrière revue avec abandon du triangle inférieur remplacé par un simple bras articulé transversal et un tirant longitudinal relié à la caisse par un silentbloc.

Freins :
Disques à l’avant et à l’arrière, in-board à l’arrière. Commande hydraulique.
Assistance à dépression Kelsey Hayes.
Direction :
Crémaillère, 2,6 tours de butée à butée.
Evolution :
01/1962 : Remplacement du plancher plat pour abaisser les sièges et augmenter la garde au toit. La traverse derrière les sièges est redessinée pour améliorer leur recul. Nouveau système de ventilation pour remédier aux dégagements de chaleur en provenance du moteur.
Pistons avec nouveaux segments diminuant la consommation d’huile et puisard en aluminium.
Rapport de pont : 3,07 au lieu de 3,31 :1 (2,93 ; 3,31 ou 3,54 :1 en option).
10/1964 : E 4,2 l : remplacement de la partie centrale du tableau de bord en aluminium bouchonné par un granité noir. Nouveaux sièges en place des baquets en forme d’ogive.

Moteur 4235 cm3 (92×106) de la MK X, 265 chevaux.
Système électrique et refroidissement améliorés.


Nouvelle boîte de vitesses entièrement synchronisée.
Freinage amélioré avec nouveau servofrein Lockheed.
Badges 4.2, mais aspect extérieur inchangé.

03/1966 : Salon de Genève (CH) : Présentation de la version 2+2 pour satisfaire le marché US, empattement allongé de 23 cm, toit surélevé et pare-brise rehaussé.








7/1967 : Nouveaux optiques agrandis, plus de carénage de phares. 2 essuie-glaces au lieu de 3.

Nouveaux étriers de disques avant à 3 pistons.
2+2 : Nouveau pare-brise panoramique plus incliné.
10/1968 : Présentation de la Type E Série 2 : Sièges redessinés, interrupteurs à basculeurs du tableau de bord remplacés par touches piano.



Caches arbre à cames striés en place de l’aluminium poli.
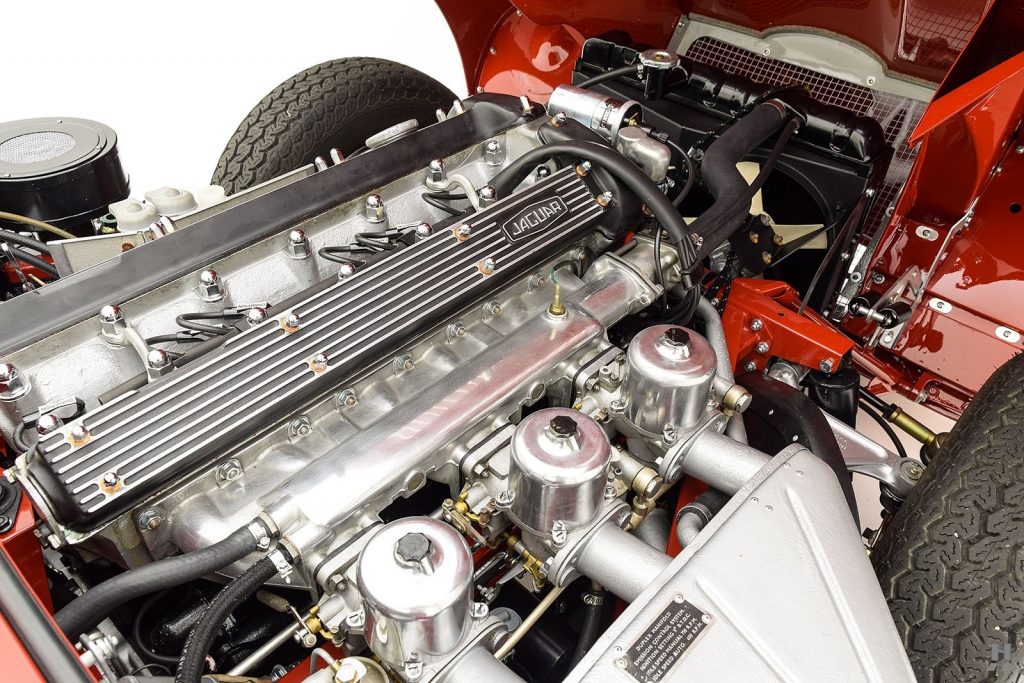
Versions US avec 2 carburateurs Stromberg CD en place des 3 SU (environ 100 chevaux de moins)
Calandre et clignotants avant agrandi.
9/1970 : Arrêt des versions 6 cylindres.
Participation à la compétition :
Le prototype E2A pour Le Mans est engagé sans succès par par Briggs Cunningham.

Les études E1A sont reprises par Malcolm Sayer (aérodynamicien de Jaguar) qui pense qu’une voiture compétitive doit avoir un treillis tubulaire et un moteur central et non une structure monocoque et un moteur avant. Il définit néanmoins le coupé Low Drag réalisé par l’atelier compétition Jaguar, jusqu’au nouveau règlement des 24 Heures du Mans qui, en n’écartant pas les Sport-Prototype, entraîne l’arrêt du développement de la voiture. La firme soutient néanmoins les meilleures écuries privées sélectionnées par le directeur de la compétition Jaguar Lofty England : John Coombs (Guilford) en particulier qui fait courir Graham Hill et Roy Salvadori entre autres.
Claude Bailey, ingénieur en chef de Jaguar demande la fabrication de 7 voitures de course basées sur la E2A le 16/03/1961 (Project n° ZP 537/24). Ces voitures reçoivent des moteurs spéciaux avec culasse retravaillée, soupapes polies, amortisseur de vilebrequin compétition, carburateurs SU avec cornets, boîte de vitesses compétition avec rapports raccourcis et embrayage renforcé. Les Voitures utilisent des caisses acier et les suspensions sont légèrement modifiées avec l’adoption de ressorts de suspension durcis.
1962 : Voiture quasi usine dérivée de la Low Drag Coupé avec structure monocoque très légère an acier, sans formes lisses, allégée de 104 kg avec, capot aluminium (gain 36 kg), immatriculée 4 WPD, poids inférieur à la GTO, et culasse Type D wide-angle. Malgré des études sur le système de freinage et les réglages de suspension en cours d’année par l’atelier compétition usine la voiture ne se comporte pas idéalement en courbe et ne sort pas de virage en passant toute la puissance au sol (mise au point encore plus difficile car les réglages des voitures pilotées par Hill et Salvadori sont totalement différents), ce qui entraîne l’achat d’une Ferrari 250 GTO par l’Ecurie Coombs (concessionnaire Jaguar) pour 1963.
1963 : Lofty England intervient et convainc Coombs de confier la GTO au département expérimental Jaguar. Sayer compare la GTO avec 4 WPD et la Low drag Coupe avec essais comparatifs et démontage du V12 Ferrari pour passage au banc. Les informations sont utilisées pour la fabrication des « E Type Competition 1963-1st aluminium » rebaptisé plus tard « Lightweight E ». Un prototype est construit sur la base de 4 WPD, dont il reprend les suspensions et le freinage avec les améliorations de l’année 1962, un capot aluminium ainsi que les montants de pare-brise et le hardtop. La base utilisée est la nouvelle caisse monocoque en alliage léger renforcée pour avoir une bonne rigidité à l’arrière surtout (goussets pour renforcer les ancrages des suspensions). Le sous-châssis standard utilise un acier modifié pour recevoir des triangles spéciaux (meilleure géométrie) et des supports moteurs plus robustes pour loger le 3,8 litres en alliage léger avec carter sec et injection.
La voiture livrée à Coombs se caractérise par un allègement de 113 kg (928 kg) par rapport à la Type E acier et un poids inférieur de 45 kg par rapport à GTO. Jaguar affirme que la Type E Standard est en aluminium, les voitures acier étant disponible en option et obtient l’homologation en GT grâce à cet artifice.
18 exemplaires sont fabriqués : Les 2 premiers expédiés aux Etats-Unis, engagement à Sebring (Cunningham et Qvale), victoire de catégorie. La voiture de Coombs est engagée à Snetterton (1 er Gl, Hill) et Goodwood (1er Gl devant les GTO de Parkes et E de Salavadori engagée par Tommy Atkins).
Competition E : Le développement est assuré par l’ingénieur libanais, Dr Samir Klat, qui crée la Type E lightweight pour les coureurs amateurs : Peter Lumsden et Peter Sargent.
Samir Klat, professeur de thermodynamique, est chargé de recherches à l’Imperial College (Londres), spécialiste dans l’étude des technologies de la combustion. Ses travaux portent sur le 6 cylindres Jaguar double arbre à cames (version alliage léger) et l’aérodynamique de la voiture. Il définit les insuffisances de la voiture et axe le développement sur les points les plus susceptibles d’apporter un perfectionnement notable (réglage du système d’injection pour avoir une puissance accrue). Il est confronté au problème des faiblesses structurelles du moteur : faiblesse de l’alésage, course trop élevée, faible entraxe entre les cylindres, petite surface des pistons limitant la masse d’air aspirée et diminuant la dissipation de la chaleur tout en limitant le régime. Des études permettent de pousser la puissance à 320 chevaux mais Klat se concentre sur l’amélioration de l’aérodynamisme et de la suspension.
Objectif : réduire la trainée aérodynamique pour augmenter vitesse maximale par la définition d’un écoulement aussi laminaire que possible. Il conçoit un toit en aluminium dans le style de la Low Drag étudiée par Malcolm Sayer fin 1962 en plus plat et plus long. Le pare-brise presque vertical est conservé le (règlement impose une interchangeabilité avec l’ancien pare-brise), entraînant une correction de la forme avec rehaussement de la ligne de toit pour avoir une courbure suffisante pour une aile portance zéro. Le capot est redessiné avec une entrée d’air plus petite et allongée dans les style de la Vanwall Grand Prix (meilleure pénétration dans l’air) et les ailes sont plus volumineuses pour recevoir des roues avant de 7 pouces (180mm). On trouve aussi des ouïes d’aération sur le sommet de capot et une prise d’air NACA forçant l’air vers les tubulures d’admission, permettant de compenser l’augmentation de la masse d’air aspiré à grande vitesse en enrichissant le mélange à pleine ouverture en 4e vitesse.
Des essais sont effectués sur l’autoroute M1 aboutissant à la réalisation de la forme de base en aluminium grâce au traçage d’un quadrillage en fils de laine sur la carrosserie. Les essais roulants ont lieu avec une voiture suiveuse prenant des photos du déplacement des brins de laine et la forme est peu à peu modifiée par Klat avec un maillet en caoutchouc pour obtenir une portance nulle. Un travail est aussi effectué sur la détermination des zones de haute et basse pression de la carrosserie amenant des prises d’air sur les premières et des des extracteurs dans les secondes. On trouvera donc 2 orifices sur le sommet de l’auvent devant le pare-brise (haute pression) pour canaliser l’air dans l’habitacle et rafraîchir le pilote sans influence sur l’écoulement d’air et des ouïes d’évacuation d’air de chaque côté de la glace arrière pour évacuer l’aitr chaud de l’habitacle, du différentiel et des freins arrières accolés au pont. D’autres écopes sont percées dans les ailes arrières pour refroidir les 2 pompes à essence. Les essais montrent aussi un « effet de sol », l’allongement de la partie arrière crée une force déportante (alors que l’équipe pense qu’il s’agit de force portante), due à un effet « venturi » inconnu à cette date, phénomène incompréhensible.
Des câbles sont aussi fixés aux suspensions pour mesurer les changements d’assiette à différentes vitesses avec une pige graduée installée dans l’habitacle. La mise au point des suspensions se fait avec l’aide de Graham Hill (essai de la voiture et conseils). On constate une oscillation de la voiture au freinage après forte accélération (déjà noté par Sargent). la voiture est alors essayée à fond sur l’anneau de Goodwood avec Klat penché à l’extérieur de la voiture par la portière ouverte pour estimer le débattement de la roue en mettant sa main gantée entre la caisse et le pneu arrière. Le problème est résolu par le montage d’articulations à bagues plus rigides.
Mécaniquement la E Lightweight reçoit des cornets d’alimentation pour le système d’injection et un réservoir d’huile en aluminium pour le carter sec. Les tubes d’échappement sans silencieux courent le long du bas de caisse droit et sont interrompus avant la roue arrière
De nombreuses pièces sont spécialement fabriquées pour la voiture : réseau de reniflards, pompe à eau spéciale compétition, boîte à eau modifiée, palonnier répartiteur de freinage, amortisseurs Koni réglables, étriers de frein agrandis Lockeed à 4 pistons, nombreuses canalisations, roues en magnésium avec pneus Dunlop Racing dans le style des Jaguar D avec écrous à 3 oreilles plus profond pour recevoir les jantes de 7 et 7 1/2 pouces. Des écopes en aluminium pour forcer l’air vers les disques pleins et le différentiel ZF sont également montées. Le différentiel reçoit un refroidisseur d’huile intégré maintenu par une platine d’ancrage en acier avec 2 ressorts hélicoïdaux de chaque côté enfermant les amortisseurs Koni réglables.Le guidage des bras inférieurs en alliage léger se fait par bras tirés en tôle emboutie et les points d’ancrages sont renforcés par goussets pour une meilleure répartition et absorption des poussées. Le soubassement fabriqué à la main.
12 Lightweight usine seront fabriquées avec une 1ère victoire lors de ses débuts à Oulton Park (course de GT, épreuve nationale du BARC), pilotée par Graham Hill, roadster bleu foncé de l’Equipe Endeavour.
2014 : Jaguar Classic fabrique 6 exemplaires de E Type Lightweight plus une voiture (Car 0) à usage promotionnel. Les voitures sont réalisées d’après les bleus de la E Lightweight. Les caisses en panneaux d’aluminium sont réalisées chez JLR à Whitney (G-B) en utilisant les mêmes process de fabrication et les mêmes épaisseurs. La voiture reçoit un arceau-cage et les seules modifications concernent les manomètres de température d’eau et d’huile plus modernes et des harnais de sécurité Willians. Le moteur 6 cylindres 3,8 litres est réalisé par Crosthwaite & Gardiner, chemisé en acier avec lubrification par carter sec, alimentation par injection ou 3 carburateurs double corps Weber 45 DCOE, 300 chevaux et couple de 380 Nm obtenu à 4500 tours. Boîte de vitesses à 4 rapports rapprochés entièrement synchronisée et embrayage mono-disque à sec. Radiateur, radiateur d’huile et vase d’expansion en alliage léger. Amortisseurs améliorés, direction à crémaillère d’origine E Type. Disques de freins avant agrandis (12 ¼ pouces), jantes 15 pouces en magnésium.